LES CHINOIS DU MARAIS
Part 1
LES CHINOIS DU MARAIS
Par Maud Prangey, Historienne d’art
Le Marais est le plus ancien quartier asiatique de Paris, surnommé le « Sentier Chinois » ou « Little Wenzhou », il est le seul quartier vraiment chinois avec Belleville, les autres quartiers étant indochinois : Viêt Nam, Cambodge, Laos.
Les Chinois en France
Au XVIIème siècle, les Chinois ont l’interdiction de sortir du territoire.
Shen Fuzong est le premier Chinois connu à s’être rendu en France. Mandarin de Nankin, converti au catholicisme, il accompagne Philippe Couplet, procureur des missions jésuites de Chine. Son voyage se déroule de 1681 à 1692, il est présenté à Louis XIV le 15 septembre 1684 où il montre comment écrire en chinois et fait une démonstration de l’usage des baguettes.
Le port de Wenzhou
En 1876, le port de Wenzhou s’ouvre et quelques colporteurs chinois apparaissent dans les rues de Paris. Environ 283 Chinois sont recensés en 1911 en France, principalement des étudiants, journalistes, intellectuels anarchistes et déjà quelques marchands de produits chinois.
La Première Guerre Mondiale
En 1916-1917, la France et l’Angleterre n’ont plus de main d’œuvre avec la mobilisation des hommes au combat. Ils décident d’engager des travailleurs chinois afin de contribuer à l’effort de guerre. Le 14 mai 1916, la France signe un traité avec le gouvernement chinois alors dirigé par Duan Qirui qui s’engage à leur fournir 150 000 « coolies » surnommés « travailleurs célestes », en réalité des travailleurs forcés, pour participer à des tâches non militaires car la Chine est neutre et ne veut pas s’engager dans la guerre contre l’Allemagne.
Le recrutement doit se faire dans le nord de la Chine, les Chinois du nord étant supposés être plus apte à supporter les hivers rigoureux. Le 9 décembre 1915, le lieutenant-colonel Georges Truptil part à Pékin et fait signer à de jeunes coolies illettrés des contrats de travail de 5 ans. Ces jeunes paysans robustes espèrent faire fortune en France ignorant totalement que l’Europe est en guerre. Initié dans le nord, la majorité du recrutement se fera finalement dans le sud, dans la région de Wenzhou. À leur arrivée, les coolies vont devoir effectuer de lourdes tâches : travaux de terrassement, réfection des routes et chemins de fer, manutention dans les ports, indispensable à la logistique militaire. Les conditions de travail épouvantables des travailleurs chinois provoquent des conflits avec les autorités françaises. Parqués dans des camps de travail, ils ont l’interdiction d’en sortir et d’entrer en contact avec la population. Mal nourris, mal chauffés, de nombreux ouvriers ne recevront jamais réellement leur salaire : 1 franc par jour pour les recrues de l'armée anglaise, 5 francs pour ceux de l’armée française qui leur donne le statut d'indigène civil mais pratique de nombreuses retenues sur salaire. Les syndicats défendent leurs droits afin d'éviter un dumping social. Alors que leurs contrats spécifient qu’ils ne doivent pas se trouver sur la ligne de front, 10 000 personnes sont exposées aux combats sur le front de l’est à la demande du Maréchal Foch qui les met à disposition du corps expéditionnaire américain en 1918. Non armés, ils creusent des tranchées, réparent des barbelés, évacuent les morts des champs de bataille. Beaucoup d’entre eux perdront la raison et se retrouveront à l’asile. Entre 10 et 20 000 chinois trouveront la mort.
La guerre terminée, ils sont utilisés pour déminer les champs, reboucher les tranchées et la reconstruction. Les survivants sont amenés Gare de Lyon pour embarquer à Marseille et être renvoyés en Chine. Beaucoup refusent de rentrer, s’enfuient et s’installent près de la Gare de Lyon. Deux à trois mille d’entre eux restent en France après la guerre. La plupart vont devenir ouvriers chez Renault et Panhard et Levassor dans les usines de Boulogne-Billancourt, formant ainsi le premier noyau de la communauté asiatique française.
Part 2
L’ilot Chalon
Dans un premier temps, ces ouvriers ouvrent des petits commerces et magasins appelés boutiques de chinoiseries et devient le premier quartier chinois de la capitale. Cet endroit est appelé alors îlot Chalon. Jusqu’à la fermeture des frontières de Mao Zedong en 1949, ces pionniers chinois seront rejoints peu à peu par d’autres: des restaurants, des blanchisseries, des ateliers de confection vont naître dans le quartier. À partir des années 30, certains migrent dans le marais près de la station de métro Arts et Métiers où ils travaillent avec d’autres immigrés, pour la plupart Juifs Hongrois, Polonais et Arméniens. L’ ilot Chalon , qui se situait dans le 12ème arrondissement le long de la gare de Lyon, fut rasé dans les années 70 pour insalubrité.
La Madeleine
Après la Première Guerre mondiale, un autre type de population chinoise s’installe à Paris dans le quartier de la Madeleine. Ils occupent les 8ème et 9ème arrondissement. Ces chinois proviennent en grande majorité de la ville de Jiangxi et de Zhejiang. La plupart sont issus de l’élite des marchands chinois et s’installent à Paris pour faire du commerce de mobilier, laques, vaisselle et produits de luxe.
Le Marais
Depuis l’époque médiévale où ce quartier était géré par les Templiers, le marais a toujours eu une longue tradition de négoce car les commerçants étaient exemptés de taxes.
Après la Deuxième Guerre mondiale, une vague migratoire de Chinois, toujours originaire de Wenzhou s’installent dans le haut Marais et densifient la petite communauté chinoise parisienne. Ils se spécialisent dans les métiers de la confection et de la maroquinerie, savoir faire qui leur a sans doute été transmis par les Juifs Polonais et Hongrois et les Arméniens. A cette époque, la population chinoise en France est estimée à 20.000 personnes environ. Ce chiffre va stagner jusqu’au début des années 80 avec la réouverture du pays. Aujourd’hui les Wenzhou possèdent la majorité des commerces de gros de maroquinerie, bijoux de fantaisie, textiles et de nombreux restaurants. La rue au Maire constitue le centre névralgique du quartier chinois, les habitants se connaissent tous et se retrouvent dans cette vieille rue pavée. Hormis Le Tango, une boîte de nuit au charme désuet située au centre de la rue, tous les commerces sont chinois : épiceries, alimentation asiatique, coiffeurs, manucures. Il y règne une ambiance villageoise.
Part 3
Le nouvel an chinois
Généralement discrets, les Wenzhou du 3ème le sont beaucoup moins au moment du Nouvel An Chinois. Tous les ans, les associations de commerçants du quartier organisent un défilé dans les rues du Marais avec costumes traditionnels, pétards, musiciens, fanfares, guirlandes et dragons. Pendant ces festivités, les commerçants installent sur leur devanture, les réverbères et les grilles de la mairie du troisième les fameuses lanternes rouges, gage de chance et de prospérité pour la nouvelle année. Preuve de la réussite économique des Chinois du Marais, ce défilé rivalise d’importance avec celui du 13ème arrondissement où la communauté chinoise et plus largement asiatique y est pourtant beaucoup plus nombreuse. Little Wenzhou semble vouloir se développer vers le Faubourg Saint-Martin où les grossistes spécialisés dans le textile pour enfants sont presque tous chinois. Également de l’autre côté du boulevard Sébastopol, une forte présence chinoise s’est implantée dans le Sentier, quartier traditionnellement juif. Hélas, il est à craindre que la rue au Maire, petit îlot populaire au cœur de Paris, subisse le même sort que la rue des rosiers, toute proche. La rénovation des vieux immeubles et la flambée de l’immobilier dans le centre de la capitale font fermer les petits commerces et les bouis-bouis remplacés peu à peu par des boutiques et restaurants plus chics.
Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shen_Fuzong
http://www.gavroche-pere-et-fils.fr/arts-et-metiers-le-plus-vieux-quartier-chinois-de-paris/
Véronique Poisson, « Les grandes étapes de cent ans d’histoire migratoire entre la Chine et la France », Hommes & Migrations, no 1254, mars-avril 2005, p. 6-17 (ISSN 1142-852X, lire en ligne [archive] [PDF]). Dossier spécial « Chinois de France », coordonné par Véronique Poisson.
Charles Gilbert, « Wenzhou-Paris, aller simple » [archive], sur L'Express,29 octobre 1998 (consulté le 8 novembre 2015).
Fabienne Tisserand, Voyage au pays du souvenir 1914-1918, Belgique, La Renaissance du livre, coll. « Les Beaux livres du patrimoine », octobre 2003, 272 p.(ISBN 2804608212), page 90 [archive]
Live Yu-Sion, La Diaspora chinoise en France : Immigration, activités socio-économiques, pratiques socio-culturelles, Thèse de doctorat, EHESS, Paris, 1991
http://toutelaculture.com/actu/histoire-breve-de-limmigration-chinoise-en-france/
http://books.openedition.org/psorbonne/991?lang=fr

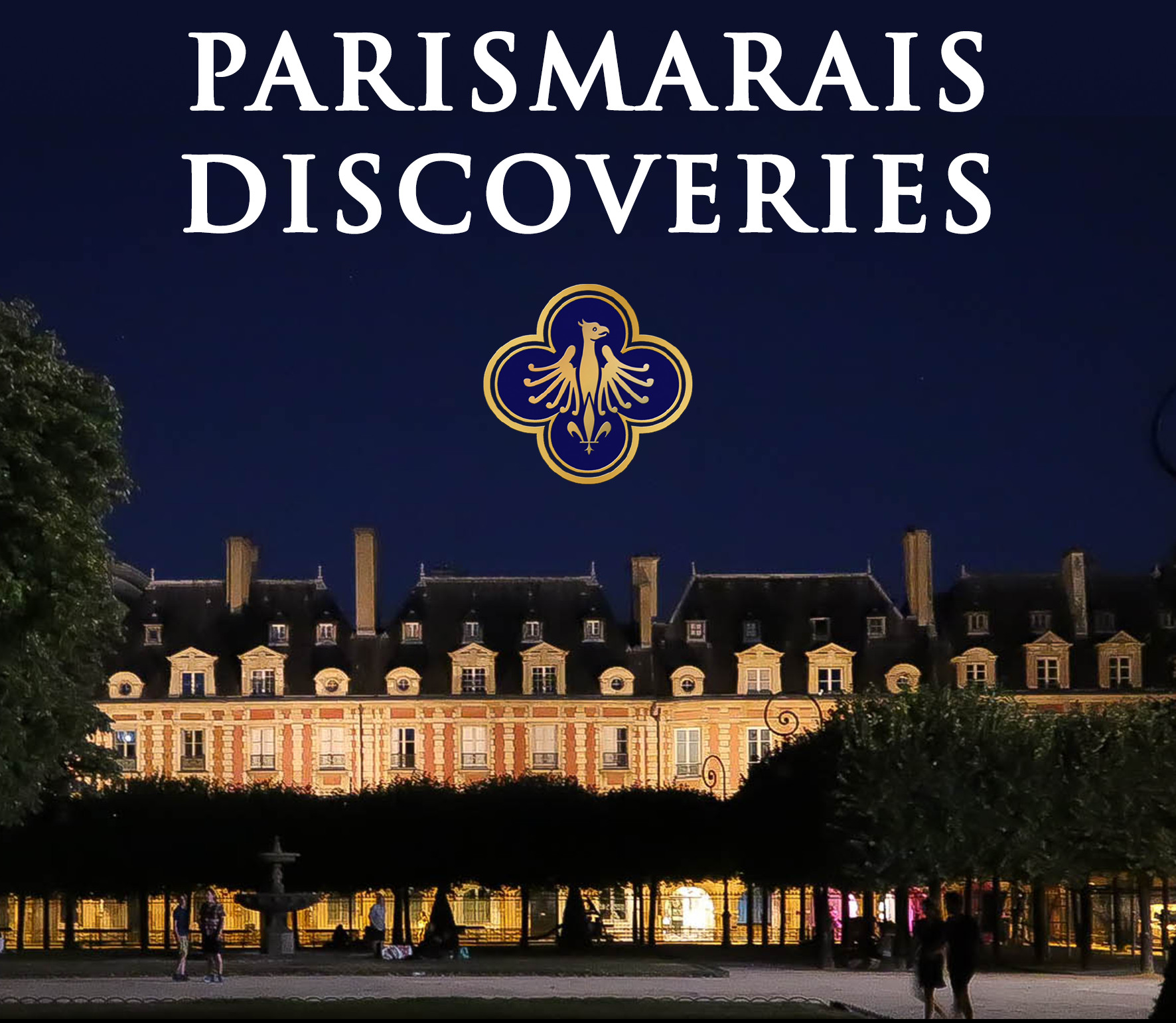
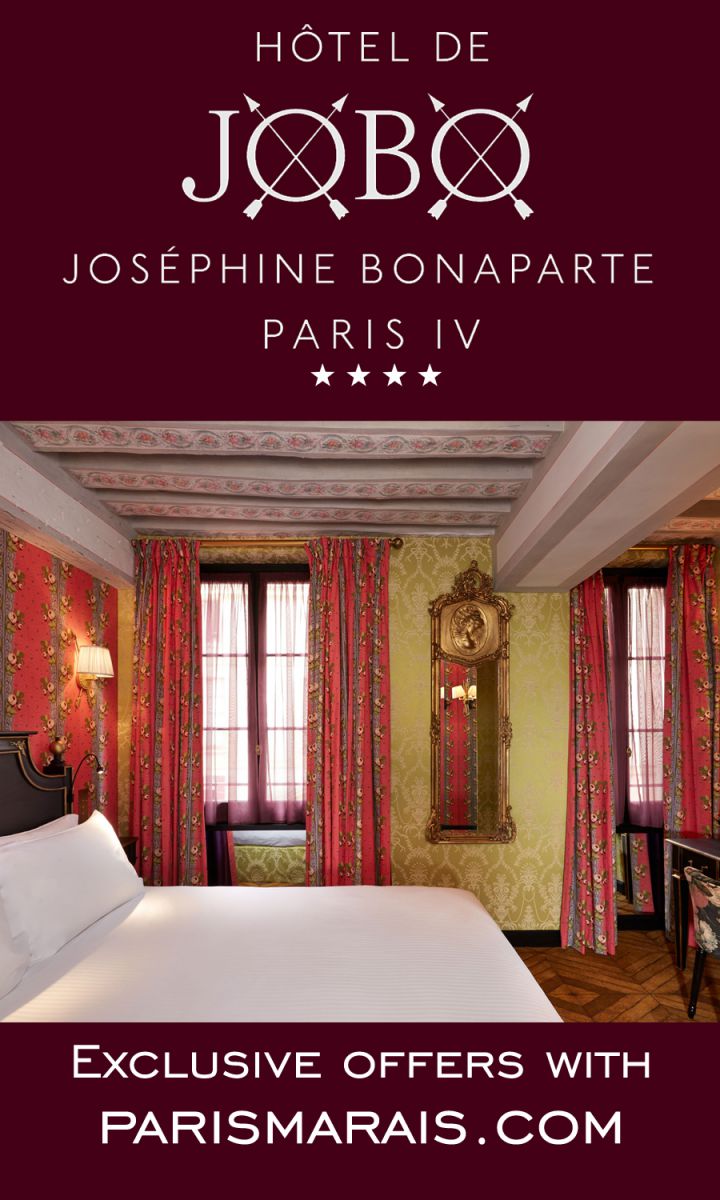

.jpg)

